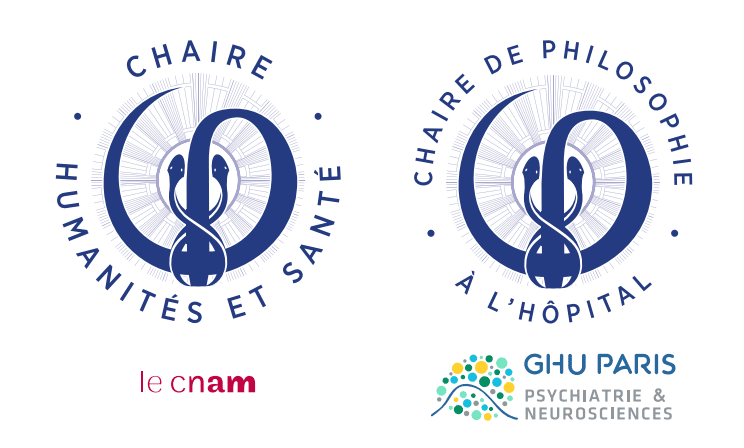|
La première séance, introductive, posait les jalons d’une réflexion sur le fascisme et ses nouvelles formes : la pauvreté matérielle vécue et inscrite jusque dans les corps, se double d’un appauvrissement de la pensée avec le développement et l’entretien d’un ressentiment que le sujet, sans cesse sollicité et mobilisé dans l’expression de son opinion sur tous les titres, ne peut digérer. Guillaume Le Blanc, philosophe, et Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, titulaire de la Chaire, ont ainsi questionné la potentialité d’une dimension fasciste à l’intérieur de chacun, examinant les mécanismes mentaux, les dynamiques sociales et les émotions qui favorisent l’émergence et la propagation de cette idéologie. Cette perspective a été approfondie plus en détail en fin de séminaire par Michaël Foessel, philosophe, qui préférait mobiliser le concept « fascisation » plutôt que le « fascisme », soulignant ainsi le processus par lequel une partie de la population - qu’elle soit majoritaire ou minoritaire - adhère progressivement à l’idéologie fasciste. Dans ce processus, la mobilisation joue un rôle majeur : mobilisation de l’attention, médiatique, technologique, etc., qui débouche sur les mobilisations des « masses » caractéristiques des mouvements fascistes. À ce titre, la séance avec Étienne Balibar, philosophe émérite, apportait une réflexion éclairante sur les liens entre fascisme et populisme, et les interrelations des fascismes entre eux.
Pour mettre en regard ces aspects de la réflexion (interrelation et mobilisation), deux séances ont porté sur les caractéristiques historiques du spectre autoritaire dans les régimes politiques. Patrick Boucheron, historien spécialiste de l’histoire de l’Italie médiévale, revenait ainsi à travers le commentaire de la Fresque du Bon gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti (1338) sur ce que la philosophie politique italienne du XIVe siècle considérait comme caractéristique d’un bon ou d’un mauvais gouvernement. Peinte sur les murs d’un établissement éminemment politique - le palais communal de Sienne -, cette fresque met en garde, pour qui exerce le pouvoir, contre les dérives qui lui sont associées. Elle renvoie ainsi à la force politique des images, une thématique grandement d’actualité aujourd’hui. À partir de ces jalons historiques de l’époque médiévale et moderne, l’historien et académicien Pascal Ory poursuivait les réflexions à l’époque contemporaine par une analyse des régimes politiques - et notamment fascistes - du XXe siècle. Spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la France au XXe siècle, il détaillait ainsi les liens entre la nation, nationalisme et autoritarisme, des liens déjà soulevés par Étienne Balibar dans sa séance, partant du double constat qu’il n’y a pas de fascisme sans nationalisme et que le fascisme n’a pas le monopole sur l’autoritaire. Penser le fascisme doit donc prendre en compte les autres formes de dérives politiques, tant dans leur conceptualisation que dans leur réalité historique.
Le séminaire conclut à certains moments sur la nécessité de « faire institution » autrement et l’enjeu de procéder au distinguo entre riposte et réplique. Il ouvre des pistes de réflexions sur les nouvelles techniques de mobilisation des corps et des esprits (réseaux sociaux, algorithmes) et donne quelques clés de lecture pour réussir à poser la limite entre le populisme et le fascime, constatant que c’est bien souvent ce continuum existant de l’un vers l’autre qui empêche de saisir le basculement. Pour approfondir ces antidotes socio-éducatifs et scientifiques, une journée d’étude est en préparation.
|