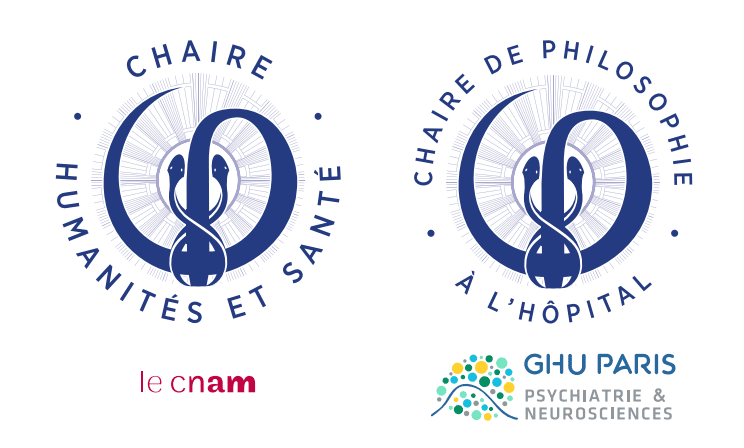|
La révolte s’oppose à une autorité qui ne lui convient pas, le plus souvent extérieure : c’est par exemple aller sciemment à l’encontre des critères de beauté, refuser de sortir, ou encore s’opposer frontalement à sa hiérarchie ou ses gouvernants. Elle se veut ainsi être une autorité par elle-même. Une autre autorité. Si, pour le sujet, cela peut avoir des incidences psychopathologiques (contrôle de son image ou de son alimentation, retrait social, etc), politiquement, c’est dans cette latitude - ou cette opposition - entre autorité extérieure et autorité de la révolte que jaillissent des considérations éthiques mobilisables pour faire avancer le monde, dans un soulèvement désirant. Les mouvements de révolte individuels et collectifs se conjuguent pour agir face à un monde qui ne nous convient pas - soit à titre personnel, soit à titre collectif. On se rappelle alors l’autre sens de gesticae en latin, qui désigne tout à la fois le mouvement et le récit épique (qu’on pense ici aux « chansons de gestes » de l’époque médiévale). La révolte chemine en équilibre entre une vitalité destructrice et une vitalité créative.
Pour décliner cette analyse, plusieurs exemples ont été pris comme le cas de l’anorexie mentale, présenté par Margaux Goldminc (Mérand). Celle-ci montre comment les jeunes femmes, surtout celles aux parcours académiques exemplaires, manifestent une peur de l’échec et un perfectionnisme tels qu’elles ne supportent pas de ne pas savoir ou de se projeter dans le temps, exigeant des résultats immédiats voire simultanés aux actions qu’elles entreprennent et strictement fidèles à ce qu’elles imaginent, ne leur permettant de fait aucun repos. Un objectif difficilement atteignable mais qui devient approchable dès lors que l’on passe par le corps et le contrôle de son poids, puisque ses variations s'observent quasi-instantanément après l’effort, le jeûne ou l’épisode vomitif. Plutôt que d’opter pour un travail conventionnel, socialisé (avec ses productions, ses réussites, ses efforts, ses échecs, ses interférences extérieures), le sujet anorexique se concentre sur son corps, immédiatement gouvernable. Mais l’objet de ce travail sur soi, entamé pour « enfin réussir » et performer quelque part, ne permet aucune reconnaissance puisque le sujet n'exprime pas sa subjectivité dans l’abstinence alimentaire. Il ne produit aucun objet dont peut se saisir autrui, avec lequel fonder un dialogue, et la reconnaissance qu’il cherche s’évapore, faisant de l’anorexie mentale un travail aliéné au sens de Marx. La séance portant sur le Jeûneur de Kafka étaye ces conclusions : pour le personnage, « le monde » le renvoie à un trop-plein d’incompréhension. Incapable de trouver la reconnaissance sociale qu’il en attend, en se risquant dans le réel, il répond par un désengagement de l’existence dans le jeûne. Ce désengagement demeure une forme d’attente paradoxale… |