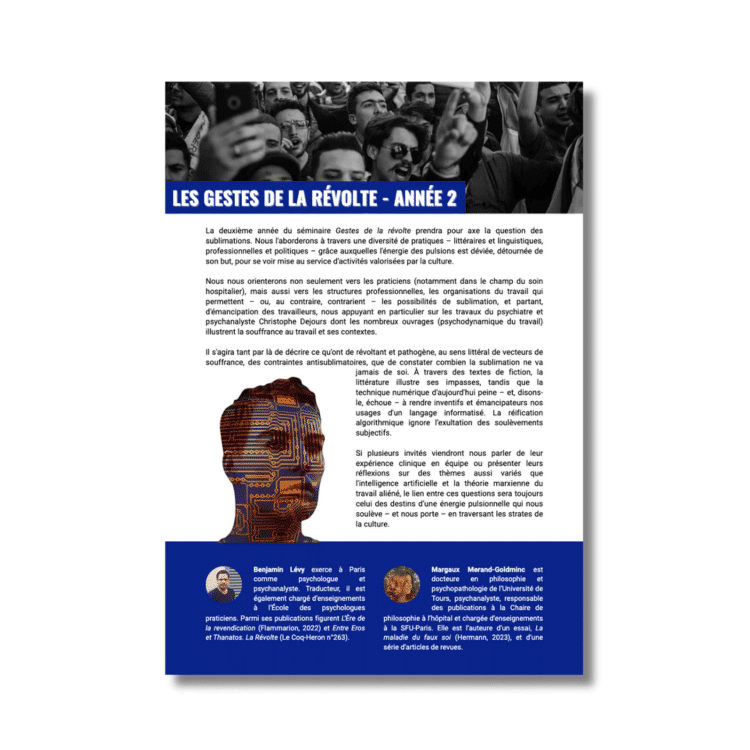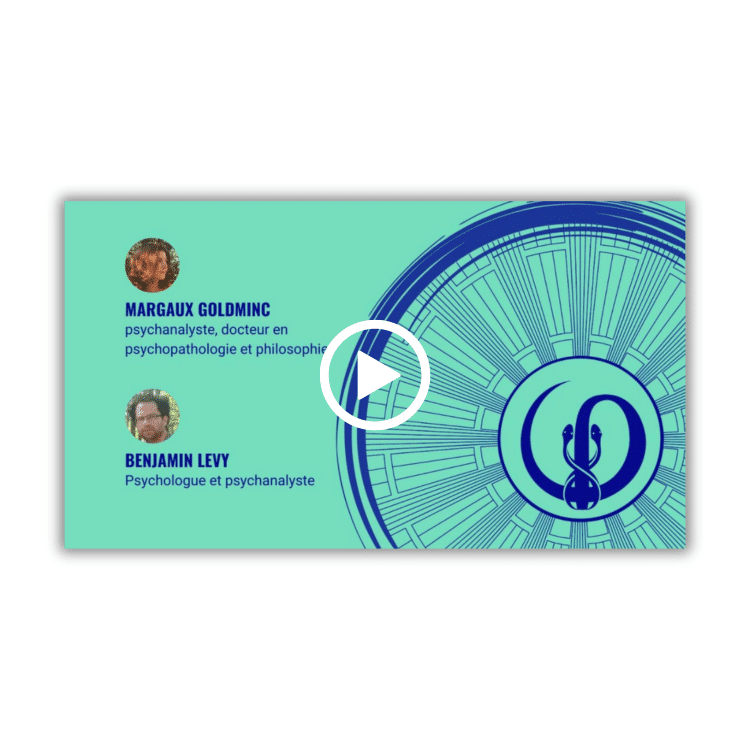Contexte de la recherche : penser une « philosophie clinique de la révolte »
La révolte s’oppose à une autorité qui ne lui convient pas. Récusant un principe d’ordre (ou de désordre) extérieur, la révolte se veut ainsi être une autorité par elle-même. Si, pour le sujet, elle peut avoir des incidences psychopathologiques (contrôle de l’image du corps ou de l’alimentation, retrait social…), politiquement, c’est dans cette latitude – ou dans cette opposition -, entre autorité extérieure et autorité de la révolte, que jaillissent des considérations éthiques mobilisables pour faire avancer le monde, dans un soulèvement désirant.
Si, dans l’institution, on pense d’abord à la non-adhésion de certains patients aux programmes de soins, à leur rejet des traitements médicamenteux, la révolte est aussi celle des soignants contre des conditions de travail… révoltantes.
Le séminaire « Les gestes de la révolte » cherche ainsi à présenter la révolte dans ses aspects à la fois cliniques et politiques. Il pose l’hypothèse d’une « philosophie clinique de la révolte », qui embrasserait l’ensemble des dualités rencontrées dans les mouvements de révolte, allant des situations les plus mineures (tirer la langue) aux psychopathologies les plus physiquement expressives (anorexie, boulimie, retrait social). Mue tant par le désir que par l’aversion, suscitant l’empathie comme le rejet, accueillie tantôt avec mépris tantôt avec admiration, mobilisant la volonté d’être vu aussi bien que le désir d’échapper au regard, la révolte peut être saisie dans toutes ses dynamiques et ambivalences, et l’un des enjeux est d’exhiber la façon dont celle-ci (à l’échelle du sujet) peut influencer la clinique elle-même (échelle de l’institution).
Le séminaire est coordonné par :
Une recherche philosophique par le cas clinique
Pour questionner cette « philosophie clinique de la révolte », le séminaire procède par études de cas cliniques ou de psychopathologies : états limites (Pr Maurice Corcos), hikikomori (Dr Raphaël Ezratty), jeûne, anorexie mentale et boulimie (Margaux Merand-Goldminc). L’année 1 du séminaire s’est attachée à chaque séance à se concentrer sur un type d’expressivité du sujet pour interroger les ambivalences de la révolte au cœur des comportements.
L’année 2 du séminaire s’intéressera, dans la continuité de la séance consacrée à la figure littéraire de l’Artiste de la faim de Kafka, au concept de sublimation comme capacité à dépasser cette révolte, et à lui donner une issue qui ne soit pas morbide. Dans la dernière séance de l’année 1, les deux responsables du séminaire reviennent déjà sur la sublimation chez Freud, mais aussi sur les théories critiques qui en ont interrogé la portée. Reconnaissant une part de violence et de destructivité pulsionnelles irréductible dans la sublimation (le corps y demeure central et la révolte n’est pas éthérée), et à partir de ces apports critiques, l’idée est d’étudier la révolte comme appel à un recouvrement des facultés, subjectives et collectives, de sublimation.
Dans le cas de l’anorexie mentale, il s’agit par exemple de s’intéresser à la façon dont la rémission produit une nouvelle norme de santé, qui n’est ni la norme « conventionnelle » (sociale), ni un retour à l’état antérieur à la maladie. Cette nouvelle norme de santé se traduit autant par une continuité du sentiment d’être que par une capacité à œuvrer à quelque chose (dégageant le corps des enjeux de survie narcissique et d’individuation). Créativité, normativité, sublimation et/ou désublimation de la révolte, aux échelles conjuguées du sujet et de l’institution (organisations intrapsychiques sublimatoires ou antisublimatoires ; organisations sociales du travail sublimatoires ou aliénées), seront ainsi approfondies à partir de la rentrée universitaire 2025-2026.
Pour aller plus loin
- Margaux Merand-Goldminc (avril 2025), « L’anorexie mentale. Du non-travail au travail aliéné », Gestions hospitalières, n°645, p. 138-141.
- Benjamin Lévy (février 2025), « Patients en obligation de soins. Aménager l’espace d’une loyauté mutuelle », Revue hospitalière de France, p. 57-59.
- Margaux Merand-Goldminc (septembre-octobre 2024), « D’où vient l’anorexie mentale ? Une révolte contre le faux soi », Revue hospitalière de France, n°620, p. 58-60.
- Margaux Merand-Goldminc (août-septembre 2024), « Organiser le vide pour ne pas l’éprouver ? Une lecture de l’anorexie mentale », Gestions hospitalières, n°624, p. 410-413.
- Margaux Merand-Goldminc (avril 2023), « L’artiste de la faim de Kafka ou l’envers de la vie manquée », La Règle du Jeu, n°78.
- Benjamin Lévy, L'Ère de la revendication, Paris, Flammarion, 2022.
- Margaux Merand-Goldminc, Maël Lemoine (2022), « L’anorexie mentale : une fatigue de ne pas être soi ? », Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, vol. 180, num. 10, 2022, p. 987-994.
- Margaux Merand-Goldminc, La maladie du faux soi, Préface du Pr Maurice Corcos, Paris, Hermann, coll. Psychanalyse, 2023.
- Benjamin Lévy et Alain Vanier (2016), « Pour introduire une clinique de la revendication », Cliniques méditerranéennes, n°93, vol. 1, p.161-174.