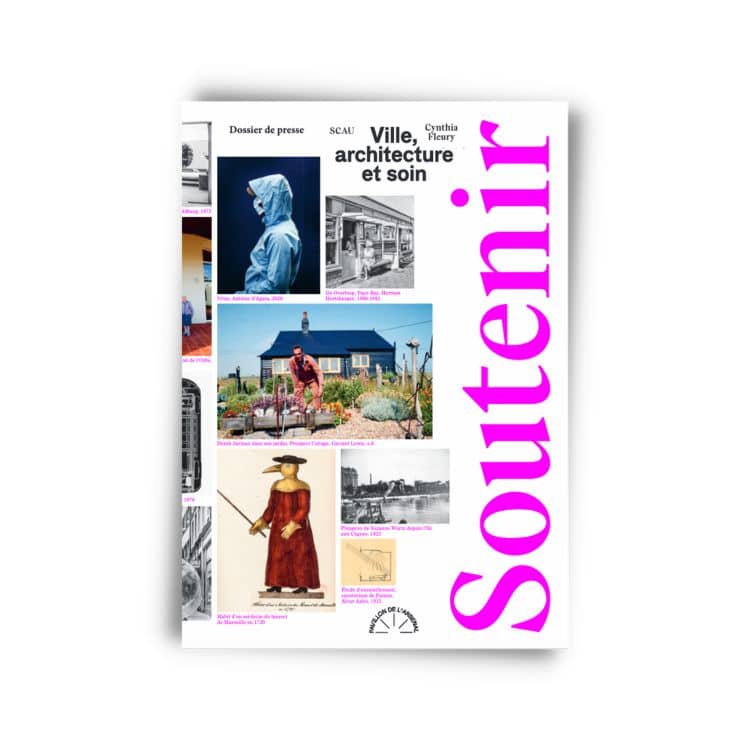L’un des enjeux des éthiques du care est de montrer que le care est une activité qui se déploie entre les personnes et qui demande des ressources spécifiques. Le care possède aussi une dimension spatiale. Il va sans dire que l’architecture a un rôle essentiel à jouer. De plus en plus, la conception de nouveaux espaces ou leur réhabilitation s’obligent à prendre en compte différents types de vulnérabilités, humaines comme naturelles (handicap physique, sensibilité à la luminosité, espaces éco-conçus etc.). Les relations entre architecture et care sont ainsi à l’origine de projets novateurs et de nouveaux parcours de formation et de spécialisation dans divers cursus académiques. C’est pourquoi la Chaire de philosophie à l’hôpital consacre une partie de ses recherches à ces questions depuis 2020, année qui marque le début d’un séminaire de recherche au long cours : le séminaire Architecture et care.
Penser les liens entre architecture et care : un séminaire dédié
Un séminaire de recherche est animé à la chaire depuis 2020 par Eric de Thoisy, architecte, docteur en architecture et chercheur associé à la Chaire de philosophie à l’hôpital. Il questionne à la fois les raisons d’être et les pratiques des espaces bâtis dans le rapport au soin, et propose un renouveau méthodologique. En analysant l’histoire, les grands concepts de l’architecture et du care (hospitalité, soin, vulnérabilité), ce séminaire s’interroge sur pourquoi penser les lieux de soin, et comment le faire. Il présente et analyse plusieurs des projets architecturaux et fait intervenir depuis quelques années  des architectes ayant pensé ces questions dans la conception au travers de leurs réalisations (hôpitaux, centres de jour, maisons de retraite, etc.). Certaines années de séminaires ont pu s’organiser autour de thématiques ou de problématiques particulières,comme par exemple l’année 5 – des daseinsarchitectures qui s’est articulée autour du prendre soin de l’« existant », veiller à son existence comprise non seulement en tant que bâti, mais aussi en tant qu’intégrité biologique et physique en tant qu’appartenance à la communauté politique.
des architectes ayant pensé ces questions dans la conception au travers de leurs réalisations (hôpitaux, centres de jour, maisons de retraite, etc.). Certaines années de séminaires ont pu s’organiser autour de thématiques ou de problématiques particulières,comme par exemple l’année 5 – des daseinsarchitectures qui s’est articulée autour du prendre soin de l’« existant », veiller à son existence comprise non seulement en tant que bâti, mais aussi en tant qu’intégrité biologique et physique en tant qu’appartenance à la communauté politique.
Ce séminaire se tient lui-même sur un lieu de soin exceptionnel, le centre de jour de l’Adamant, bateau amarré à la Seine, et a ainsi fait l’objet d’une séance spécifique avec ses concepteurs (Gérard Ronzatti, architecte, et Eric Piel, psychiatre) et se déroule en partenariat avec les Hôpitaux de Saint-Maurice.
Pour (re)découvrir ce séminaire :
Partenariat avec l’ENSA Paris – Belleville
Depuis septembre 2023, ce séminaire est aussi un cours pouvant faire l’objet d’une validation pour les étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (ENSA Paris-Belleville). Le programme du séminaire est ainsi conçu en commun avec des professeurs de l’ENSA Paris-Belleville et se concentre essentiellement sur le premier semestre. La collaboration se prolonge ensuite avec la réalisation de projets étudiants aux modalités d’examen partagées.
Le 19 janvier 2024 s’est ainsi déroulé l’examen de projets étudiants portant sur la conception d’un lieu d’accueil de jour pour les enfants autistes, âgés de 3 à 10 ans. Parmi les membres du jury se trouvaient Eric de Thoisy, responsable du séminaire, et Cynthia Fleury, titulaire de la Chaire de philosophie à l’hôpital. 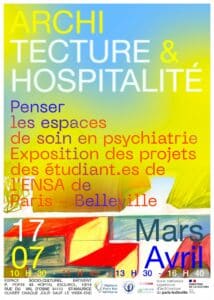 Ces projets ont ensuite été présentés au public le 16 mars 2024 sur l’Adamant lors d’un événement spécial en présence de Cynthia Fleury, Éric de Thoisy, Elisabeth Essaïan et Laetitia Overney (enseignantes à l’ENSA Paris-Belleville, responsables du studio « Architecture et hospitalité » et de la plateforme « Architecture et précarités »), mais aussi Gérard Ronzatti (architecte de l’Adamant) et Arnaud Vallet (cadre de santé et coordinateur de l’Adamant).
Ces projets ont ensuite été présentés au public le 16 mars 2024 sur l’Adamant lors d’un événement spécial en présence de Cynthia Fleury, Éric de Thoisy, Elisabeth Essaïan et Laetitia Overney (enseignantes à l’ENSA Paris-Belleville, responsables du studio « Architecture et hospitalité » et de la plateforme « Architecture et précarités »), mais aussi Gérard Ronzatti (architecte de l’Adamant) et Arnaud Vallet (cadre de santé et coordinateur de l’Adamant).
En 2024-2025, le sujet portait sur une réhabilitation d’un service de l’hôpital Esquirol. Les propositions faites par les étudiants sont disponibles sur le site du studio de projet Architecture et hospitalité, tout comme les résultats, photos de projets et le film de présentation ayant accompagné l’exposition « Penser les espaces de soin en psychiatrie » réalisée avec et à partir de ces projets étudiants (17 mars – 7 avril 2025).
L’année 2025-2026 proposera aux étudiant de réfléchir à l’implantation de lieux de soin psychiatrique en contexte hyper-urbain, dans le centre de Paris, en transformant des bâtiments existants. Le travail intégrera des séances de co-conception avec soignants et patients de l’Adamant, dont certains étaient déjà intervenus précédemment dans le séminaire (séances avec Bruno Voillot et Elise Andreux).
Exposition
Les recherches sur architecture et care ont donné lieu à une exposition au Pavillon de l’Arsenal à Paris, l’exposition « Soutenir. Ville, architecture et soin », qui s’est déroulée du 6 avril au 25 septembre 2022. Inspirée de l’ouvrage Soutenir, sous la direction de Cynthia Fleury et de l’agence SCAU, l’exposition s’ouvre sur l’Hôtel-Dieu de Paris et suit une série de lieux et de territoires abordés sous le prisme du care, de la santé et de la sollicitude, à la lumière de disciplines médicales, urbaines, philosophiques et artistiques.
Cette exposition questionne la place que la cité accorde à l’acte du soin, et à tous ses acteurs, le soigné, le soignant, et les autres. Elle rencontre l’histoire du soin, et l’histoire des lieux du soin qui l’accompagne, et montre que cette histoire est avant tout une histoire de soutien ; l’histoire des lieux-tenant, des lieux et des architectures qui nous tiennent et nous soutiennent, plutôt qu’ils nous détiennent ou nous contiennent – même si l’histoire de ces lieux-là, ceux contenant, est à raconter en même temps puisque c’est souvent la même.
Cette histoire a été présentée dans sept espaces (eux aussi tenus et tenant), correspondant à sept dimensions complémentaires des relations entre soin, ville et architecture. Plans, maquettes, photographies et installations diverses ont composé le parcours du visiteur qui est invité à découvrir ces sept thématiques, qui sont autant de dimensions de l’histoire des relations entre soin, ville et architecture :
- les distances, entre la santé et la maladie, et entre la ville et ses lieux de soin ;
- les éléments, ces territoires qui sont soignants (ou non soignants) avant d’être de l’architecture ;
- les formes, celles que prend l’hôpital, et plus généralement l’institution du soin ;
- les frontières, traçant les limites des gestes et des lieux du soin, du plus intime au plus public ;
- les nécropoles, et autres lieux du soin que nous portons aux morts ;
- les hétérotopies, architectures alternatives où s’inventent d’autres formes de soin ;
- les inhabitables enfin, ces territoires malades dans lesquels l’architecte doit « prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient », pour paraphraser le poète Francis Ponge. Et à ces sept espaces, un autre est attenant : les portraits vidéo de neuf lieux franciliens, qui sont des productions archétypales du soin (et du non-soin) comme principe d’aménagement du territoire, y sont projetés.
Conférence du mardi 5 avril 2022 au Pavillon de l’Arsenal : Quelle place la ville doit-elle accorder au soin ?
SOUTENIR – Ville, architecture et soin
Conférence de Cynthia Fleury et Eric de Thoisy au Pavillon Sicli. © Fondation Pavillon Sicli
Une seconde édition de l’exposition s’est tenue du 19 avril au 2 juin 2024 à la Fondation Pavillon Sicli.
Pour en savoir plus
Publications
- Coline Periano (novembre 2024), « À quoi ressemblent les hôpitaux ? Appropriation de pensée, espace et subjectivité pour le soin hospitalier », Soins, n°890, p. 60-63.
- Hugo Martin (mars-avril 2024), « Penser par cas. Du soin dans l’architecture expérimentale », Revue hospitalière de France, p. 86-89.
- Eric de Thoisy (mars 2024), « Architecture et soin : des forces et des intérêts communs », AOC, en ligne.
- Coline Periano (janvier-février 2024), « De l’architecture hospitalière à l’hospitalité », Soins, n°882, p. 60-63.
- Hugo Martin, (novembre 2023), « L’architecture comme expérience, habiter autrement avec la philosophie de John Dewey », Soins, n° 880, p. 60-63.
- Coline Periano (mai-juin 2023), « Hospitalisation et architecture : approcher l’espace hospitalier à travers la sensibilité des patients », Revue hospitalière de France, n°612, p. 36-41.
- Éric de Thoisy (mars 2023), « Quand le moindre lieu est de soin : architecture et vulnérabilité », Soins, n°873, p. 60-63.
- Marie Tesson (octobre 2022), « Prendre soin de l’avenir, Quatre pistes pour une architecture du care », Les Cahiers d’Europan 16, Villes vivantes, p. 73-78.
- Marie Tesson et Bénédicte Penn (juin 2022), « Influence de la référence culturelle sur l’architecture et le soin », Soins, n°866, p. 58-62.